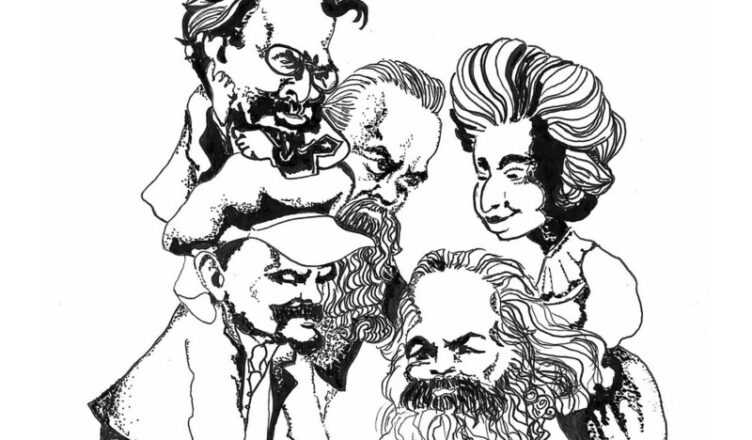Pour autant, la bourgeoisie émergente est généralement favorable à l’établissement d’une monarchie constitutionnelle ou d’une république oligarchique. Ainsi, la révolution américaine repose de 1779 à 1782 sur l’armement multiethnique de la population masculine pour affronter militairement l’ancienne puissance coloniale, l’Angleterre coiffée par une monarchie. Mais la nouvelle république tolère l’esclavage et n’accorde même pas le droit de vote à tous les citoyens libres de sexe masculin. En outre, elle instaure une présidence élue de manière indirecte qui contrebalance le pouvoir du parlement lui-même divisé en deux chambres (élues alors au suffrage censitaire).
La révolution française de 1789 débouche d’abord sur une monarchie constitutionnelle dont le parlement est élu au suffrage masculin, censitaire et indirect. En 1792, la population laborieuse organisée et armée (les sans-culotte) arrache la république et le suffrage universel et direct masculin. La contrerévolution thermidorienne y met fin dès 1794.
Au début du 19e siècle, seule une partie de la petite bourgeoisie urbaine (artisans, boutiquiers, instituteurs, avocats, médecins, journalistes…) est véritablement à la fois républicaine et démocrate. En dépit de l’hostilité de nombreux socialistes à la lutte politique (Owen, Saint-Simon, Fourier, Hess, Proudhon…), le premier mouvement ouvrier de masse, le chartisme, se bat à partir de 1838 en Grande-Bretagne pour le droit de vote et des élections annuelles. À son contact, la Ligue des communistes se prononce en 1847 pour les libertés démocratiques, pour une république reposant sur le suffrage universel, pour un parlement détenant tous les pouvoirs.
Mais, lors de la révolution de 1848-1849, la bourgeoisie allemande se révèle incapable de jouer un rôle radical, ni même républicain. En définitive, elle préfère se soumettre à la monarchie prussienne que prendre le risque d’une révolution populaire incontrôlable. En France, la révolution populaire, armée, renverse en février 1848 la monarchie. Mais la 2e République bourgeoise réprime de manière sanglante la classe ouvrière en juin : « Fut livrée la première grande bataille entre les deux classes qui divisent la société moderne… Le voile qui cachait la république se déchirait » (Marx, Les Luttes de classes en France, 1848-1850).
Par conséquent, là où subsiste la monarchie, tout en se battant pour la république et pour les libertés démocratiques, la classe ouvrière doit préserver son indépendance et bâtir son propre parti ; là où l’État bourgeois prend la forme d’une république, la classe ouvrière ne peut lui faire aucune confiance, elle doit défendre et étendre les libertés, exiger l’armement du peuple et entamer la lutte directe contre la bourgeoisie et son État « dont le but est de perpétuer la domination du capital » (Marx, Les Luttes de classes en France, 1848-1850).
Les leçons de la révolution européenne de 1848-1850 sont confirmées par la Commune de Paris en 1871. Certes, les travailleurs parisiens sont républicains et recourent au suffrage universel, mais ils sont aussi armés, ce qui leur permet de mettre en place le premier gouvernement ouvrier de l’histoire, une république sociale. Avec la complicité de la monarchie prussienne, la bourgeoisie française (ses cliques monarchistes et cléricales comme ses factions républicaines et franc-maçonnes) unie autour de Thiers calomnie la Commune, l’assiège et l’écrase de manière sanglante. La 3e République bourgeoise accorde le suffrage universel masculin en 1875, tout en réprimant les grèves, en poursuivant les conquêtes coloniales de la monarchie et en militarisant la société pour préparer la guerre contre l’Allemagne.
L’État bourgeois, républicain ou monarchiste, parlementaire ou autoritaire, garantit le despotisme du capitaliste sur le lieu de travail et la contrainte pour les salariés de vendre leur force de travail au capital, même s’ils sont formellement libres, au contraire des esclaves et des serfs : « La république apparait en Europe pour ce qu’elle est dans son essence, ce qu’elle est réellement en Amérique, la forme la plus accomplie de la domination de la bourgeoisie » (Engels, La République en Espagne, 1er mars 1873).
En Allemagne, en 1918, c’est la révolution prolétarienne qui renverse la monarchie. Mais l’armée professionnelle bourgeoise n’a pas pour autant disparu. Le gouvernement de l’Assemblée constituante (la République de Weimar) lance la police et les officiers contre les travailleurs en 1919.
En 1945, le peuple français, armé, restaure les libertés démocratiques et conquiert une protection sociale limitée, mais inédite. Avec la complicité du PS-SFIO et du PCF, le général de Gaulle désarme les masses, consolide l’État bourgeois, tente de rétablir l’empire colonial. Écarté, il revient au pouvoir en 1958 grâce à un coup d’État militaire et liquide le régime parlementaire de la 4e République bourgeoise, remplacé par un régime présidentiel : « La Constitution se détruit elle-même en faisant élire le président au suffrage direct par tous les Français… Il est, lui, l’élu de la nation… Il a, en face de l’Assemblée nationale, une sorte de droit divin » (Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1851).
Aujourd’hui, LFI prétend octroyer au « peuple », du moins s’il vote bien, une « 6e République », sans même supprimer la présidence. Mais, en France, le mot d’ordre de république ou d’assemblée constituante a perdu tout aspect progressiste depuis des décennies. Le « front républicain » a servi, à deux reprises, de prétexte au PCF, au PS, à LFI et au NPA d’aider à élire Macron. Tous les partis présents au parlement se disent républicains, RN inclus, et tous veulent renforcer la police et l’armée de métier, hostiles à la démocratie et contrerévolutionnaires : « La république, tant qu’elle est la forme de la domination bourgeoise, nous est tout aussi hostile que n’importe quelle monarchie » (Engels, Lettre à Lafargue, 6 mars 1894).
L’intérêt des travailleurs n’est pas de replâtrer l’État bourgeois, mais de l’abattre et de le remplacer par le pouvoir ouvrier, par une république socialiste.