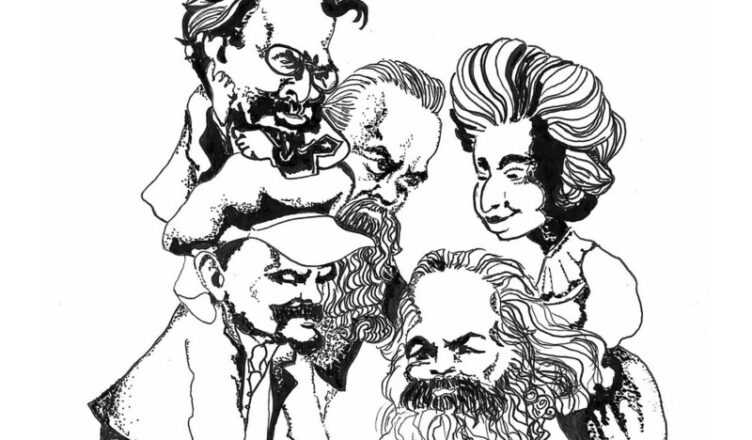Si on est contraint de vendre sa capacité de travail à ceux qui, dans la société capitaliste, détiennent les moyens de produire (le capital productif), on court le risque de ne pas trouver preneur. On se retrouve, pour une durée aussi inconnue qu’angoissante, dans le chômage. C’est pourquoi le premier parti ouvrier de masse (le chartisme britannique né en 1838) appelait cette partie de la classe ouvrière « l’armée industrielle de réserve ». Cette réserve de main-d’oeuvre est aujourd’hui majoritairement constituée des jeunes des pays dominés et des femmes du monde entier. Un signe irréfutable de la restauration du capitalisme en Russie et en Chine au début des années 1990 fut le rétablissement d’un « marché du travail », de l’exploitation par des patrons en concurrence d’un côté, de la réapparition du chômage de l’autre.
Les statistiques du chômage et de l’emploi sont souvent biaisées, pour des raisons idéologiques. Ainsi, la définition de l’OIT (qui est un organisme international de collaboration de classe qui a compté plusieurs dirigeants de la CFDT, de la CGT et de FO, grassement payés) exclut les chômeurs découragés En France, l’INSEE mesure chaque trimestre sur cette base : 2,3 millions en aout 2024. L’autre source officielle est la DARES qui a le mérite de construire plusieurs indicateurs du chômage qui vont de 2,8 millions (catégorie A selon France travail) en octobre 2024 à 5,8 millions pour la définition la plus large (A+B+C+D+E de France travail).
La définition des chômeurs est encore plus restreinte quand il s’agit de les indemniser. Actuellement, en France, 50,5 % des chômeurs A+B+C ne bénéficient pas du régime de l’assurance-chômage.
Le taux de chômage serait plus élevé s’il était rapporté uniquement à la classe ouvrière. Mais il est construit en rapportant le nombre de chômeurs à la « population active » qui comprend, outre la classe ouvrière, les classe intermédiaires (de l’encadrement et des indépendants) et même une partie de la bourgeoisie (les hauts fonctionnaires, les manageurs comme ceux d’Auchan et Michelin).
La taille de la population active dépend surtout de la démographie mais la part des chômeurs en son sein résulte de deux mouvements antagoniques du capitalisme.
La vocation de chaque capital est de grandir. Quand il s’accumule, il augmente à la fois les équipements et la main d’oeuvre (ouvriers, employés, techniciens, cadres…).
Néanmoins, le capital ne se reproduit pas en conservant la même proportion de travailleurs par rapport aux équipements (machines, locaux, moyens de transport…). La concurrence pousse les capitaux individuels (les entreprises) à augmenter la productivité du travail. Le résultat est une tendance à l’augmentation de la composition organique du capital et une baisse de la valeur de l’unité de marchandise produite. Pour produire la même quantité de biens ou de services, il faut moins de travailleurs. Dans les conditions capitalistes de production, la hausse de la productivité tend à créer du chômage.
Le capitalisme est inévitablement cyclique. En phase de croissance, quand le taux de profit pousse à s’étendre, la « création d’emplois » l’emporte sur la « destruction d’emplois ». Mais en temps de crise (quand le taux de profit s’effondre) et de dépression (tant que la rentabilité reste faible), c’est l’inverse.
Les manageurs des groupes capitalistes ne licencient pas pour augmenter les dividendes de l’année des actionnaires mais parce qu’ils veulent garantir durablement le profit total de l’entreprise (qui est réparti ensuite entre investissement, intérêts versés aux prêteurs, dividendes, leur propre rémunération mirobolante). Les décisions de multiples entreprises de ne pas embaucher ou de licencier ont pour résultat, involontaire, la montée du chômage global.
Quand le chômage est élevé, les patrons s’en servent pour faire pression sur les salariés qu’ils conservent ou les rares qu’ils embauchent. Le revers est que, économiquement, cela pèse sur la capacité d’écouler les marchandises et que, politiquement, la légitimité du capitalisme est minée.
Alors, il devient intéressant pour des partis bourgeois de renvoyer les femmes au foyer, de désigner comme des « assistés » (fainéants et parasites) les chômeurs aidés d’une manière ou d’une autre (assurance chômage ou revenu de solidarité active en France), d’accuser les ouvriers et les employés étrangers (qui n’ont pourtant licencié personne) d’être responsables du chômage.
Les États bourgeois, même ceux qui restent formellement démocratiques, tendent à se prendre à la gorge, économiquement d’abord par des mesures protectionnistes (qui ne font qu’aggraver le marasme mondial), puis militairement pour tenter de faire retomber les difficultés économiques et politiques sur d’autres (ce qui fait baisser le chômage national mais aussi tue une partie de la population des pays belligérants),
Pour se débarrasser du chômage, il faut en finir avec le capitalisme.
Sources
- Le Dictionnaire critique du marxisme conçu en 1982 par des intellectuels proches du PCF comprend une entrée « chômage » (p. 149-150). Après quelques références obligées à Marx, son auteur (Guy Caire) explique, contre Marx et malgré l’évidence historique, que « au XIXe siècle, le chômage était essentiellement périodique… est devenu avec le capitalisme monopoliste d’État un fait massif et chronique ».
- L’article « chômage » plus récent (2012-2024) de l’encyclopédie collective en ligne Wikirouge est meilleur. Cependant, un/e des auteurs, par sa défense des « cotisations sociales » toutes confondues, point 10) concède au bismarckisme, un système adopté par le général de Gaulle après la 2e Guerre mondiale, devenu le crédo du PCF, de LFI, des chefs de la CGT, FO, SUD, la FSU… L’article témoigne aussi d’une indulgence envers le keynésianisme (point 8), la branche de la pseudo science économique bourgeoise qui constitue l’idéologie économique de la plupart des partis ouvriers bourgeois et de quasiment toutes les bureaucraties syndicales dans le monde.
- Karl Marx, Le Capital, I, 1867-1872
- Karl Marx, Le Capital, III, 1864-1882
- Ligue communiste, Licenciements, chômage, 1971
- Pierre Salama, Jacques Valier, Une introduction à l’économie politique, 1973
- Louis Gill, Fondements et limites du capitalisme, 1996