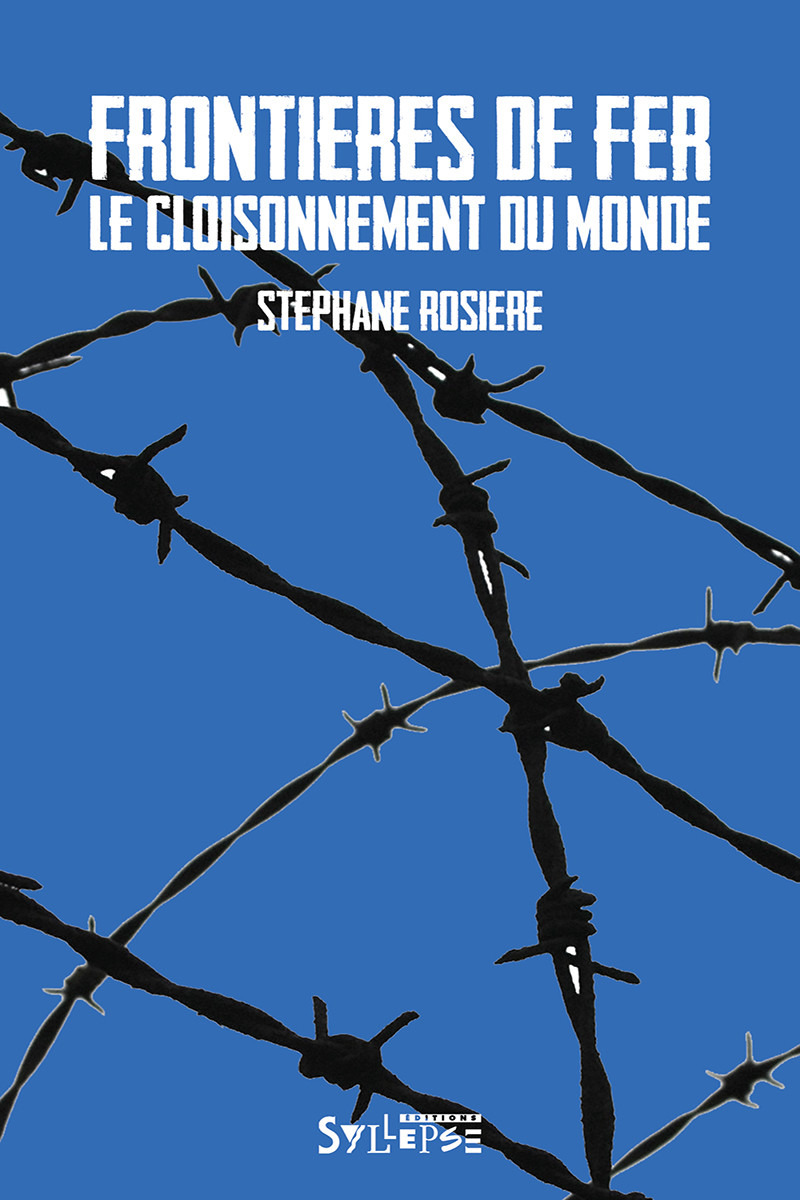Un monde toujours plus fermé
L’effondrement du rideau de fer a laissé planer l’illusion de l’apparition d’un nouveau monde tourné vers une plus grande ouverture. Certains parlaient alors de fin de l’histoire, entendant ainsi que s’ouvrait alors la fin de l’époque des guerres et des révolutions, vers les lendemains qui chantent de la mondialisation. Quelle ne fut pas la déception de tous ceux qui croyaient en cette narration. Le rideau de fer a été remplacé par des frontières de fer. Tel est le titre du livre de Stéphane Rosière, paru en 2020.
Depuis les années 1970, les contrôles aux frontières se sont progressivement renforcés, avec la remise en cause de la liberté de circulation à la suite de la crise de 1973, avec la construction de clôtures aux frontières de l’Union européenne (Ceuta et Melilla dès 1994), avec le renforcement des tensions internationales à la suite des attentats de 2001, avec les déplacements migratoires provoqués par les guerres au Moyen-Orient (Libye, Syrie…). Le monde compte aujourd’hui 25 000 km de barrières terrestres, sur 45 États (près du quart de la totalité des États du monde). Trois-quarts d’entre elles ont été érigées au XXIe siècle. Pour le moins c’est un signe de raidissement. Au-delà des plus emblématiques, que sont les murs entre les États-Unis et le Mexique, entre la Palestine et Israël, autour de l’Inde (6200 km, soit plus de 40 % des frontières terrestres de ce pays), le livre rend compte de tous ces dispositifs physiques établis aux frontières nationales.
À vrai dire il s’agit d’un cloisonnement (association de la contrainte et du contrôle) plutôt que d’une réelle fermeture, tant il est illusoire de penser pouvoir empêcher des populations de se déplacer, de penser qu’on puisse arrêter les flux migratoires par la force. Une barrière frontalière implique une soumission obligatoire au contrôle de l’État. Parfois la surveillance aux frontières est militarisée (déploiement de troupes, emploi de matériel militaire, parfois celui utilisé en Irak et en Afghanistan…), signe de durcissement du régime migratoire, partie émergée des systèmes de contrôle. Il peut s’agit de simples clôtures de barbelés, comme entre la Chine et la Mongolie, mais sont également mis en œuvre des mécanises de plus en plus sophistiqués, comme à Ceuta et Melilla entre le Maroc et l’Espagne, ou en Californie à la frontière mexicaine. Il existe également des barrières virtuelles, plus rares (entre la Jordanie et la Syrie, entre la Slovaquie et l’Ukraine) avec capteurs, traitement d’images, drones… et des barrières maritimes. Le contrôle frontalier s’est ainsi développé (avec des check points), et il s’est souvent accompagné de lieux d’enfermement (en France les centres de rétention administrative), signe de de criminalisation de la migration. Tous les continents sont concernés par les barrières (la plus longue est de 3 326 km entre l’Inde et le Bangladesh), en particulier l’Eurasie (et surtout le Moyen-Orient depuis l’invasion de l’Irak en 2003). Tous les régimes politiques le sont également, tant il apparaît n’existe pas de lien entre degré de démocratie et degré d’ouverture internationale.
Une fermeture asymétrique
Ces murs font écho aux quartiers fermés que l’on trouve dans certaines villes. Il s’agit d’un moyen mis en œuvre par les plus riches pour contrôler l’accès à leur secteur. L’auteur évoque la téichopolitique, qui désigne toute politique fondée sur le cloisonnement des espaces, sur la construction de murs. Force est donc de constater que si les marchandises circulent de plus en plus librement, c’est loin d’être le cas des personnes. Les zones de libre-échange ne sont pas des zones de libre circulation. Il est frappant que plusieurs pays membres de l’UE soient exclus de l’espace Schengen (Roumanie, Bulgarie, Croatie, Irlande, Chypre). Non seulement la circulation des personnes est entravée mais elle est surtout asymétrique. En fonction de leur origine, les individus n’ont pas le même droit au déplacement. Les personnes aisées et blanches sont ceux qui circulent le plus facilement (Erasmus, déplacements professionnels, vacances), alors que les populations réellement mobiles (nomades, migrants…) sont stigmatisées. Déplacement en business class pour les uns, en low cost pour les autres. L’auteur évoque une dissymétrie du capital spatial. Cela dépend très largement du passeport : en Europe occidentale et en Amérique du nord essentiellement, le passeport donne droit à plus de 150 destinations sans visa. En Afrique, en Asie du sud, il en autorise souvent moins de 25. Cela dépend aussi du revenu : les barrières sont construites par des pays plus riches que leurs voisins. En moyenne, le PIB par habitant du pays qui construit une barrière est sept fois supérieur à celui de son voisin ainsi entravé.
Le développement d’un discours contre les migrations
Le discours de légitimation de ces contrôles contient trois composantes : lutte contre les trafics, contre le terrorisme et contre l’immigration clandestine. À propos du terrorisme une hiérarchie a longtemps existé entre le degré d’acceptabilité idéologique perçue des migrants, avec par ordre décroissant les réfugiés, puis les migrants dits économiques (qui pourtant fuient la pauvreté), puis les terroristes (alors pourtant que nombre de terroristes sont des nationaux, comme pour l’attentat de Charlie hebdo et du Bataclan, pour ne citer que ceux-là). Ainsi les réfugiés ont longtemps été protégés du discours stigmatisant les migrants, en raison de leur statut protecteur légitimant une situation de fragilité. Or les séparations entre les trois catégories s’avèrent être de moins en moins étanches idéologiquement, et les réfugiés sont de plus en plus assimilés aux migrants économiques, eux-mêmes de plus en plus assimilés aux terroristes. Cette perception s’est trouvée renforcée par les textes de loi, avec l’affaiblissement de la protection légale des réfugiés via l’apparition de statuts intermédiaires, comme la protection subsidiaire. Le dernier point fait écho aux discours s’articulant autour de la théorie aussi médiatises que fallacieuse du grand remplacement, autour de discours sur la submersion migratoire, alors que les chiffres de l’immigration sont faibles (la population migrante représentait 2,5 % de la population totale en 1960, 3,3 % en 2015) et relativement stables sur longue période, autour du fantasme mortifère de l’agression démographique.
L’encouragement d’un business de la migration
Si le discours dominant de pays les plus riches est de plus en plus ouvertement défavorable aux migrations, créant ainsi tensions et fermetures, se développe parallèlement un marché considérable, qualifié par l’auteur de téichoéconomie, pour désigner la dimension économique et financière du cloisonnement. En d’autres termes certains ont des intérêts économiques considérables au cloisonnement des frontières. Cela implique des acteurs publics (organisations internationales, États, collectivités locales), qui définissent les normes de contrôle aux frontières (le budget de Frontex; l’agence européenne de garde-frontières, était de 6 millions d’euros en 2005, de 700 millions en 2022). Ils externalisent en partie la gestion des migrants en privatisant l’organisation du contrôle des frontières. Cela implique donc également le secteur privé, qui développe des outils de surveillance aux frontières et de contrôle des individus, qui intervient dans la construction et l’entretien des barrières (le cout s’élève à plusieurs millions d’euros par kilomètre). Il s’agit d’une interaction entre acteurs publics et privés (blindage, sécurisation, terminaux biométriques), des lobbies d’armement et de contrôle, des sociétés de conseil, de logistique, de gestion des données, de bâtiment, avec des entreprises veillant à la sécurité maritime, des ingénieurs en surveillance, et à la clé des investissements financiers considérables, les chefs d’État jouant souvent le rôle de VRP.
Cela implique enfin des acteurs informels : la fermeture a considérablement accru le rôle des mafias diverses, comme les cartels au Mexique, qui contrôlent les passeurs, tirant des revenus du franchissement illégal des frontières. Le xénophobie business dégage ainsi des milliards d’euros. Il s’agit d’une activité en réseaux multiformes, avec une tendance à l’organisation en équipes : captation des flux financiers (sommes à payer), corruption des fonctionnaires, passage de drogue, rapt des migrants… soit sept milliards d’euros de revenu en 2016. Ainsi les politiques de restriction de l’immigration sont une aubaine pour les mafias. Pour traverser il faut payer cher, d’autant plus cher que le contrôle est serré. Pour trouver de l’argent, les migrants sont contraints aux travaux forcés, au vol, à la prostitution… Ils sont victimes d’une grande mortalité (d’autant plus forte que le contrôle est sévère en raison de la difficulté renforcée pour contourner les barrières), de nombreuses violences (non-assistance à personne en danger, enfermements, séparations parents-enfants, balles en caoutchouc, reconduites forcées, racket…) alors qu’ils recherchent la protection. L’auteur fait le parallèle avec les guerres civiles, où prédomine une dissymétrie entre des forces paramilitaires et des civils en déplacement, avec leur lot de massacres, de viols, de prédation. C’est ainsi qu’il apparaît de plus en plus clairement que l’objectif des contrôles n’est pas de réduire les coûts puisqu’ils sont très coûteux et que leur objectif de sécurité n’est pas certain.
Cet ouvrage est ainsi d’une grande utilité en ce qu’il apporte un éclairage très pointu et fort documenté, d’une grande utilité pour resituer les déplacements de population, au-delà des parcours de vie individuels, dans un contexte plus général.